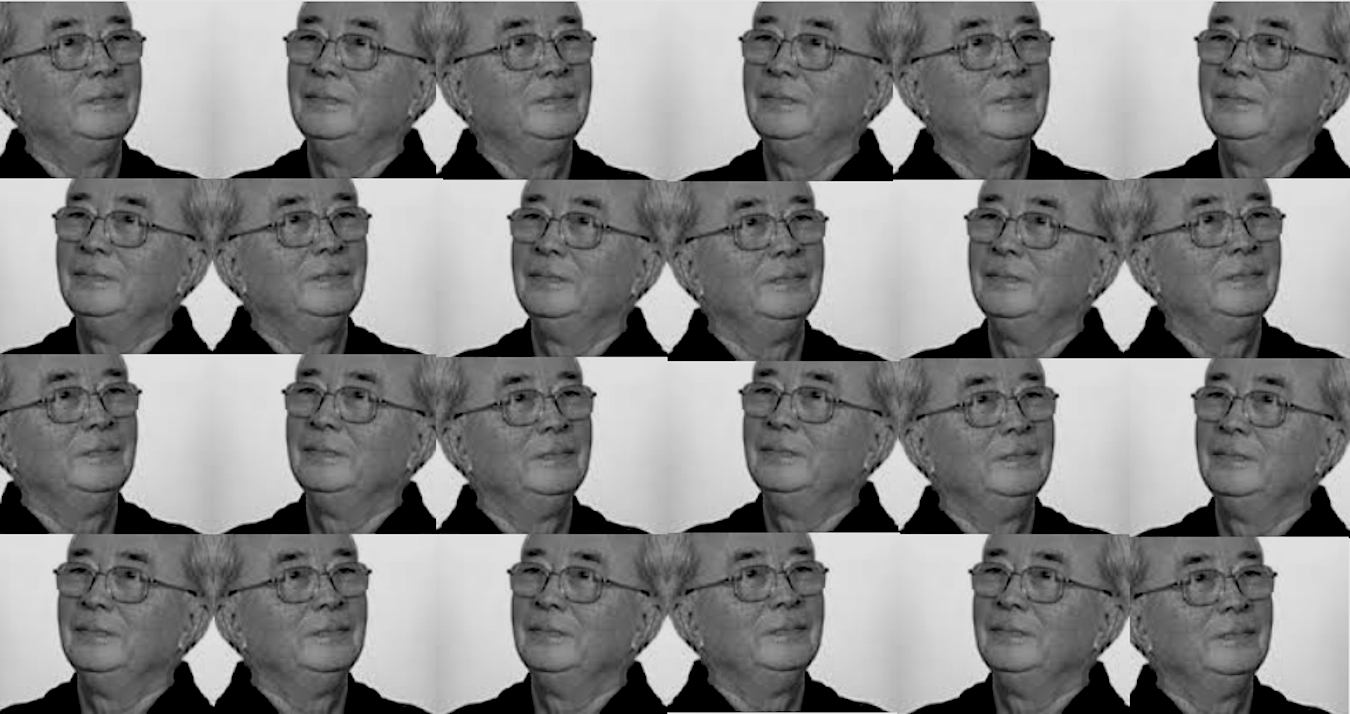Pierre Brocheux, l’historien du Vietnam, de l’Asie du Sud-Est, raconte ses parcours — enfance, formation au sens large du terme, c’est à dire : l’homme et la science de l’Histoire. Il porte son regard sur l’étude vietnamienne, du métissage, de la colonisation, du système éducatif… Sans manichéisme. Pierre Brocheux est un des rares historiens qui a vécu, vit dans sa peau de ce qu’il étudie.
L’enfance pendant la colonisation
Nguyễn Thụy Phương : Vous avez passé votre enfance au Sud du Vietnam, à l’époque où l’on l’appelait la Cochinchine…
Pierre Brocheux : Je suis né à Chợ Lớn en 1931. Ma mère était issue d’une famille vietnamienne naturalisée française. A l’époque, le mot naturalisation désignait l’admission à la citoyenneté française. La famille Trương était indigène, au sens étymologique du terme, mais au sens juridique les Trương n’étaient pas « sujets français ». J’ai donc passé mon enfance dans un milieu familial mixte où nous parlions français mais aussi viêt. Ma grand-mère qui s’occupait de moi dans mon jeune âge ne parlait pas un mot de français. Nous avons toujours habité dans des quartiers mixtes peuplés d’Européens, de métis, de Viêt, d’Indiens des établissements français de l’Inde particulièrement Pondichéry, de Cambodgiens et de Chinois : la cité Heyraud, plus tard le théâtre d’un massacre en septembre 1945, et à notre retour de France, en 1935 ou 1936, dans le quartier de Dakao.
Etiez-vous scolarisé au Vietnam ou en France ?
Ma scolarité, de la maternelle au secondaire, s’est déroulée dans des écoles françaises qui elles aussi étaient mixtes, surtout l’école primaire supérieure, baptisé collège d’Adran que je quittai pour entrer en sixième au lycée Chasseloup-Laubat où les classes étaient, elles aussi, ethniquement mixtes mais avec une majorité d’Européens. En 1944-1945, j’ai été « évacué » à cause des bombardements alliés, et transféré au lycée Yersin à Đà Lạt. L’insécurité générale et la fermeture du lycée pendant plusieurs mois ont conduit mes parents à m’envoyer en France en juillet 1946. Je repris mes études secondaires au lycée Condorcet à Paris. Après le baccalauréat je me suis inscrit à la faculté des Lettres de Paris installée à la Sorbonne qui, à l’époque, était aussi le siège de la faculté des Sciences de Paris. Après l’année de propédeutique (la première année, ndlr) j’ai choisi les études d’Histoire : licence, diplôme d’études supérieures, CAPES d’Histoire et Géographie et doctorat de troisième cycle. Sous la direction de l’historien Jean Chesneaux qui était un spécialiste de l’histoire de la Chine contemporaine mais qui a écrit deux ouvrages sur l’histoire contemporaine du Vietnam, j’ai fait ma thèse portant sur le delta du Mékong entre 1860 et 1960. Mais je l’ai abordé moins sous l’angle de l’histoire coloniale que sous celui du peuple et de la société du Nam Bộ.
Vous avez assisté, pendant votre adolescence, à plusieurs évènements majeurs qui ont changé le paysage politique du Vietnam pour la période post-coloniale…
Dans les années 1934-1936, mon père a perdu son emploi à cause de la grande crise économique, dite « Crise de 1929 ». Nous avons dû partir pour la France où nous avons été accueillis par ma famille paternelle et où mon père a retrouvé un emploi stable. Mais après 2 ans, ma mère ayant la nostalgie du quê hương (« pays natal » ou « sol natal », ndlr) nous sommes revenus au Vietnam. Nous avons subi la recrudescence des bombardements alliés tandis que les Japonais mettaient fin à la domination coloniale de la France le 9 mars 1945. J’ai donc connu la capitulation japonaise suivie presque immédiatement de la révolution indépendantiste vietnamienne d’août 1945. J’ai assisté aux grandes manifestations pour l’indépendance qui rassemblaient momentanément les principales forces politiques : parti communiste (sous le paravent Việt Minh) et Thanh Niên Tiền Phong /Jeunesses d’Avant-Garde, groupes trotskistes, Phục Quốc Hội (les Caodaistes), Dân Xã Hội (les Hòa Hảo); ces forces s’opposèrent mais ce fut le Việt Minh qui prit le pouvoir en août 1945, d’où il écarta les trotskistes, les Cao Dai et les Hoa Hao. Les communistes ont effectué la même opération que dans le nord et le centre du pays. Le général britannique D.D Gracey qui commandait les troupes anglo-indiennes venues désarmer les troupes japonaises, a expulsé les nouvelles autorités vietnamiennes et celles-ci — le Việt Minh — ont appelé la population à quitter la ville afin de pouvoir l’assiéger. J’ai vécu le siège de Saigon et l’arrivée des premières troupes françaises; elles étaient venues combattre les Japonais, mais ceux ci ayant capitulé entre temps, « restaurer la souveraineté française » était alors devenu leur mission officielle…
« Retour à la source »
Qu’est ce qui vous a amené à étudier l’histoire du Vietnam et de l’Asie orientale ?
Le fait fondamental est d’être né et avoir grandi dans une société coloniale où la race était le critère de la hiérarchisation sociale. La race vous assigne votre place dans la société. La condition de métis était inconfortable, un métis eurasien se rendait compte très tôt qu’il était assis entre deux chaises, que le statut juridique — la citoyenneté française qui le plaçait théoriquement dans la catégorie sociale dominante et dans le statut européen — ne correspondait pas à sa condition socioprofessionnelle réelle. Les « Français de l’Inde » habitant et travaillant en Indochine étaient placés dans une situation analogue. J’ai pris conscience très tôt de ce paradoxe et du malaise qu’il engendrait.
Le deuxième facteur déterminant est que le paysage et l’ordre sociétal auquel j’étais accoutumé, ainsi que le climat politique ont été complètement bouleversés par la Seconde Guerre mondiale : d’abord la défaite de la France et son occupation par l’armée allemande, puis la présence japonaise ont affaibli, discrédité la « suprématie blanche », le langage de l’époque. Le soulèvement général du peuple vietnamien, toutes composantes politiques réunies, a donné le coup de grâce à la domination impériale occidentale, comme dans le reste de l’Asie. J’ai donc pris conscience très tôt de la fragilité de l’ordre colonial et de la vulnérabilité des peuples.
Vous avez enseigné pendant plusieurs années dans un lycée français à Saigon…
Pour mon premier poste, j’ai demandé un détachement auprès de la Mission culturelle dépendant du ministère des Affaires étrangères. Je fus nommé au lycée Jean-Jacques Rousseau (anciennement Chasseloup-Laubat). Initialement, mon intention était un bref séjour de deux ans, pour revoir mes parents. En fait, j’ai renouvelé mon engagement et je suis resté à Saigon jusqu’en juin 1968. J’y enseignais l’histoire et la géographie en suivant les programmes de l’enseignement français, mais je me dois de préciser que les programmes en question n’étaient pas étroitement franco ou européo-centrés : ils étaient ouverts sur l’histoire mondiale, notamment en classe de terminale. En 1963-1964, deux collègues français — Philippe Langlet, Roger Legay — et moi-même avons été chargés de rédiger des fiches pédagogiques centrées sur l’histoire du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est. Par ailleurs, je précise que 15 heures d’enseignement par semaine étaient consacrées à la langue, l’histoire et la littérature du Vietnam, les cours étant assurés par des professeurs vietnamiens.
Saigon des années 1960 devait-elle être Saigon de votre enfance ?
Lorsque j’ai débarqué à Saigon, les premiers affrontements armés avaient éclaté dans le delta du Mékong et en particulier dans la province de Hà Tiên, à la frontière vietnamo-cambodgienne. Un incident symptomatique a eu lieu au moment des grandes vacances scolaires. En effet, une semaine auparavant, la voie ferrée avait été sabotée entre Saigon et Phan Rang (ville côtière du centre de pays, ndlr); lorsque ma famille et moi avons pris le train pour Nha Trang, notre attention fut attirée par le wagon blindé avec une section de l’armée qui se trouvait en tête du convoi. En 1961 et 1962, j’ai assisté au bombardement du palais présidentiel, par deux aviateurs, au putsch manqué des parachutistes du général Nguyễn Chánh Thi et finalement au coup d’état militaire qui a abattu le pouvoir de la famille Ngô Đình Diệm (1963).
Quelqu’un formé à l’observation et à l’analyse historique comme je l’étais ne pouvait se désintéresser de ce qui se passait sous ses yeux, d’autant que j’avais renoué des relations avec des camarades vietnamiens que j’avais connu à Paris. Eux mêmes, souvent diplômés des « grandes écoles » ou des facs participaient à un titre ou un autre à l’administration, au développement économique et culturel de leur pays et/ou s’engageaient politiquement. Certains avaient accepté de coopérer avec le nouveau régime, qui était à leurs yeux une option nationaliste — et non communiste — crédible, d’autres étaient en liaison avec le Front de libération du sud-Vietnam (FNLSVN) fondé officiellement en 1960, d’autres encore étaient engagés dans la mouvance Đại Việt (« Grand Vietnam ») anti-communiste et anti-diêmiste. Un mouvement bouddhiste prônait la paix et la neutralité, il prit de l’ampleur en s’opposant à Diêm et au fur et à mesure que la guerre embrasait toute la péninsule avec l’intervention massive des Américains.
Renaissance des études coloniales en France
Quand la renaissance des études coloniales s’est-elle opérée ?
Le Đổi Mới (« Rénovation ») est la condition première de l’évolution de la culture vietnamienne autant que l’essor économique. L’historiographie a bénéficié de la nouvelle donne, même si elle se heurte encore à la pesanteur idéologique : postulats, interdits sous des prétextes souvent fallacieux. Toutefois, depuis deux décennies, l’histoire officielle et notamment l’histoire enseignée, est soumise à questionnement voire à révision, par des publications ainsi que par internet où s’expriment des blogueurs intérieurs et ceux de la diaspora. Du côté de la recherche et des publications françaises, cette reprise est inaugurée et dynamisée par le retour de l’École française d’Extrême-Orient à Hanoi en 1993 et l’ouverture de son centre d’Hô-Chi-Minh-ville en 2013. L’Institut de recherche sur le développement (IRD) a rejoint l’EFEO sur le terrain des recherches scientifiques. Si les archives nationales du Vietnam ont été progressivement ouvertes aux étrangers, il en fut de même pour les terrains de recherche des agronomes, des économistes, des anthropologues, ethnologues et sociologues. La coopération scientifique et technique a porté ses fruits à travers maints colloques et publications conjointes.
Comment l’historiographie s’est-elle renouvelée ?
La sortie de trente années de guerre s’accompagne progressivement d’un changement de paradigme. Le courant dominant de « l’ère française » était anticolonialiste, elle traitait la face sombre du moment colonial. En contrepoint, l’histoire écrite par les colonisés était « résistancialiste », elle exaltait un passé grandiose qui justifiait et nourrissait le combat héroïque contre l’oppression étrangère.
Des deux côtés, ces histoires étaient fondées sur une opposition binaire permanente frappées au sceau du manichéisme. Cette vision des relations franco-indochinoises antagonistes survivent au 21è siècle dans les histoires officielles des pays indochinois mais aussi dans l’historiographie occidentale, en premier lieu en France. Mais une histoire alternative est apparue dans les années 1990, elle éclaire tous les registres du régime colonial français en même temps qu’elle explore la complexité de l’évolution des sociétés indochinoises qui se recomposent au cours du 20è siècle. Elle éclaire notamment les stratégies adoptées par les élites locales pour résister à l’ordre colonial et le subvertir sans violence. L’observation, l’analyse et le récit focalisent la dialectique réformiste et « évolutionnaire » et non le refus intransigeant et le choc frontal. On passe d’un angle de vision obtus et réducteur à 360° d’ouverture.
La vietnamologie
Pourriez-vous nous parler des chercheurs français et américains des études vietnamiennes de votre génération ?
J’ai conduit mes recherches et travaux en pleine Guerre du Vietnam, qui fut en réalité une deuxième guerre d’Indochine. Ce fut une époque où le monde entier était le théâtre de mouvements révolutionnaires, en France comme aux États-Unis, il y avait entre les universitaires américains et nous-même des relations étroites et parfois amicales, nombre d’entre eux comme plusieurs d’entre nous participions au mouvement international contre l’intervention américaine au Vietnam. Nous comme eux nous intéressions à la période coloniale, mais aussi aux mouvements indépendantistes, révolutionnaires, anticolonialistes. Lorsque la guerre a pris fin, que le mouvement Tiers-mondiste, que le camp soviétique s’est fracturé, que le Vietnam a été réunifié et soumis à un régime communiste autoritaire, les centres d’intérêt des historiens ont changé ou se sont déplacés.
Votre parcours de vie personnel et professionnel se lie à la colonisation, depuis votre enfance jusqu’à votre carrière scientifique. A travers le « recul historique », une notion des sciences historiques, que pensez-vous de la « perestroïka » à la vietnamienne ?
La notion de recul historique qui met à distance les relations entre français et vietnamiens — et Indochinois : ne jetons pas les Cambodgiens, les Laotiens, les minorités ethniques dans les oubliettes de l’Histoire — dans une optique plus large, n’est pas le temps mesuré mais la durée bergsonienne où s’opèrent des emprunts et des syncrétismes.
Le recul historique n’est pas un moment vide ni une parenthèse avec des pointillés, il est un moment plein. Dans le Vietnam réunifié, le recul historique se remplit lorsqu’en 1986, les dirigeants de la République socialiste du Vietnam proclament le Đổi Mới (« Rénovation »). Les réformes économiques — sortie de l’économie dite socialiste — en étaient la composante majeure mais, surtout à l’étranger, la dimension culturelle et donc politique est passée inaperçue ou fut méconnue. Or, le discours de Nguyễn Văn Linh, secrétaire général du Parti communiste, au quatrième congrès de l’Union nationale des écrivains et des artistes, a provoqué une réelle libération des esprits, des voix, des plumes et des pinceaux. En revanche la parole politique — et avec elle l’historiographie — qui s’exprima librement en 1989, 1990, 1991, se heurte encore aujourd’hui à des obstacles.
Comment les politiques de rénovation et d’ouverture du Vietnam ont-elles impacté les études vietnamiennes à l’échelle internationale ?
Un fait très important est l’ouverture des archives, car jusque là soumis à une législation restrictive, les témoins et acteurs se mettent à parler ou à écrire. Il y a au moins deux conséquences à ces changements. L’une concerne l’histoire de la colonisation et l’autre l’histoire du Vietnam. Les travaux récents portent sur les interactions et les échanges entre colonisateurs et colonisés, sur le fruit principal de ces interactions : l’émergence de la modernité vietnamienne. Mais en même temps les historiens retournent vers le passé : archéologie, histoire des religions, arts et littérature. L’objectif est ici de confronter le passé au présent, l’ancien et le nouveau. Dans ce registre, les historiens français proposent d’excellents travaux qui illustrent le renouveau, ou plutôt la régénération de ce que l’on appelait l’orientalisme que l’on accusait d’être poussiéreux. Mais les historiens américains s’intéressent eux aussi à l’histoire ancienne du Vietnam tandis que certains d’entre eux, notamment des Vietnamo-américains revisitent l’histoire de la République du Vietnam ou approfondissent l’histoire du régime nord vietnamien[1]. Je pense pour ma part que les historiens d’ici et d’outre-Atlantique ont pris une bonne direction en répondant aux interpellations du présent et en tournant résolument le dos aux polémiques anticolonialistes mais aussi anti-communistes de papa.
[1] A History of Vietnamese de K W. Taylor; Vietnam. A New History of Vietnam de C. Goscha; Misalliance. Ngo Dinh Diem, the United States, and the Fate of South Vietnam de Edward Miller; Vietnam. A history from earliest to Time to the Present de Ben Kiernan, etc…
Entretien a été réalisé en français par Nguyễn Thụy Phương à Paris en mars 2017. Nguyễn Thụy Phương est chercheuse associée à l’université Paris Diderot et l’université de Genève.
Notes :
- L’entretien a été réalisé en français, toutefois, Pierre Brocheux a utilisé certains termes en vietnamien, en quốc ngử (écriture nationale i.e. transcription latinisée de la langue Viêt). Pour cela, nous prenons le parti pris de conserver l’écriture à la vietnamienne. C’est-à-dire : avec des accents de tonalité.
- Le texte de la chercheuse Nguyễn Thuỵ Phương a été légèrement revue et rendue plus compréhensive par Vo Trung Dung — concernant le contexte vietnamien — pour un lectorat plus large.
- La correction a été effectuée par Vo Trâm Anh.